Élevés dans le strict respect des principes de la religion juive, privés d’une éducation séculière, en Israël et au Québec d’anciens ultra-orthodoxes portent plainte contre leur État. Ils estiment que l’éducation qu’ils ont reçue les a rendus incapables de trouver du travail et de s’intégrer dans la société.

À la manière d’un enfant timide, Yossi David tire nerveusement sur les manches de son tee-shirt. Il n’a pas l’habitude d’être interviewé, et encore moins d’être assis aussi longtemps en face d’une inconnue. Il faut dire qu’au cours des 21 premières années de sa vie les seules femmes avec lesquelles il a pu parler étaient des membres de sa famille : mère, sœurs, cousines et tantes.
Dans la communauté ultra-orthodoxe où il a grandi, les interactions entre hommes et femmes sont prohibées en dehors du cercle familial. Certains hommes vont même jusqu’à détourner le regard et à se cacher les yeux de la main s’ils croisent une femme sur un trottoir de Mea Shearim, le quartier des haredim, « les craignants Dieu » de Jérusalem.
En plein coeur d’une ville dont il est pourtant complètement coupé, ce quartier évoque un retour vers le passé — rappelant un peu les ghettos d’Europe centrale du XIXe siècle. Vêtus de leurs longs manteaux noués telles des robes de chambre et de leur shtreimel, un chapeau rond en fourrure, les Juifs ultra-orthodoxes portent bien le surnom qu’on leur donne en Israël : les hommes en noir. Yossi était l’un d’eux.
Dans sa « vie d’avant » , comme il l’appelle, sa penderie était d’une profonde tristesse. Déjà, il n’avait pas beaucoup d’habits. La faute à un budget familial serré. Comme beaucoup d’autres familles haredim, celle de Yossi vivait dans la pauvreté. Ses pantalons se ressemblaient tous : noirs et coupés droits. Ses quelques chemises blanches, toutes achetées au même endroit, étaient identiques. Yossi, qui a laissé derrière lui ce monde en noir et blanc il y a de cela quatorze ans, se rappelle parfaitement sa première fois sans uniforme : « Très vite, j’ai compris que je ne reviendrais jamais en arrière ».
Pourtant, aller de l’avant n’a pas été chose facile. « C’est comme si j’avais émigré dans un nouveau pays sans en connaître les codes », explique le jeune homme qui a pourtant passé toute sa vie en Israël. Lui, qui avait déjà du mal à adresser la parole à ses compatriotes laïcs, a dû trouver un logement et un travail sans « aucune compétence et aucun savoir ».

Et pour cause, grandir dans une communauté ultra-orthodoxe, c’est grandir dans l’idée que tu dois « passer ta vie à étudier, pas à travailler », explique-t-il. De son époque d’écolier en yeshiva (NDLR, l’école talmudique), il se souvient vaguement de quelques matières profanes : un peu de mathématiques et les lettres de l’alphabet latin. « Et puis vers dix ans, c’est fini, tu n’étudies plus que la Torah », soupire-t-il. En effet, c’est bien à l’étude exclusive des textes sacrés qu’est dédiée l’intégralité de la vie des « hommes en noir ».
En rejoignant la société “profane”, ce garçon qui a grandi sans télévision, radio, ni internet s’est vite rendu compte du fossé culturel qui le séparait de ses concitoyens. « Plus je comprenais l’étendue de mon ignorance, plus ma soif d’apprendre grandissait. » Cependant, en possédant le niveau scolaire d’un enfant de CM2, il lui était quasiment impossible de reprendre des études.
À force de cours du soir et de nuits blanches passées à étudier, le jeune israélien a fini par décrocher son bac à l’âge 25 ans, avant de devenir étudiant à l’université hébraïque de Jérusalem. Aujourd’hui âgé de 35 ans, il poursuit ses études, conscient de faire figure d’exception. Là où il a brillamment réussi, la majorité de ses compagnons de galères ont eux abandonné.
À Jérusalem, il existe une poignée d‘associations qui viennent en aide aux jeunes ultra-orthodoxes qui choisissent d’abandonner leur communauté pour s’intégrer à la société israélienne. Elles leur fournissent pendant quelques semaines des habits, un hébergement et même parfois des cours d’hébreu — car dans certaines communautés ultra-orthodoxes, on parle exclusivement le yiddish.
En revanche, c’est tout de suite plus compliqué lorsqu’il s’agit de reprendre un semblant de scolarité. C’est l’une des raisons pour lesquelles Yossi a créé l’association « Sortir pour changer », en compagnie de 300 anciens Juifs ultra-orthodoxes. Leur objectif : l’intégration. Ils ont fait de l’accès à l’éducation une de leurs priorités.

À la fin de l’année 2015, 53 des membres de l’association ont décidé de porter plainte contre Israël. Leur grief ? L’État ne leur aurait pas fourni une éducation de base leur permettant d’accéder aux études supérieures. Pour eux, c’est bien lui qui doit être tenu pour responsable. Après tout, « il finance aux trois quarts le système éducatif ultra-orthodoxe », précise Yossi.
Lucide, le jeune homme poursuit : « Nous ne voulons pas changer le programme des yeshivot, mais nous voulons que l’État se penche sur le problème et qu’il crée un programme spécifique de remise à niveau ». Jusqu’à présent, l’État israélien n’a pas son mot à dire sur le système éducatif ultra-orthodoxe, même si un pourcentage toujours plus important d’enfants israéliens y est scolarisé. Au début des années 1980, seulement 5,7% des enfants israéliens étaient scolarisés dans une yeshiva (NDLR, un centre d’étude de la Torah et du Talmud ; généralement dirigé par un rabbin), contre près d’un tiers aujourd’hui.
Estimant qu’il n’est pas de sa responsabilité – mais de celles des parents – de garantir l’éducation des enfants, l’État israélien a d’abord tenté un recours. Ce dernier s’est vu débouté en mars dernier. Le procès aura donc lieu. Yossi, lui, n’est pas vraiment étonné que le gouvernement ait tenté de se dédouaner. Comme il l’explique, si Israël est officiellement laïc, le poids de la religion est présent absolument partout.
Au début des années 1980 seulement 5,7% des enfants israéliens étaient scolarisés dans une yeshiva, contre près d’un tiers aujourd’hui.
Paradoxalement, bien que différentes communautés ultra-orthodoxes y vivent en totale autarcie selon un mode de vie ancestrale, leur influence est omniprésente. En plus d’un pouvoir religieux incontestable, les haredim exercent un pouvoir démographique croissant. De nos jours, ils représentent près de 10% de la population. Pourtant, opposée à toute forme de contraception, cette communauté enregistre un taux de fertilité plus élevé que la moyenne des Israéliens. Ils pourraient représenter plus d’un quart de la population en 2059.

Dans le domaine de la politique aussi, leur influence n’est plus à démontrer : de nos jours, ils font purement et simplement partie intégrante du gouvernement. Sans les deux partis ultra-orthodoxes, Shas et Yahadut Hatorah, Benyamin Netanyahou n’aurait pas pu former de coalition gouvernementale aux dernières élections de mars 2015. C’est grâce à eux qu’il a pu conserver son poste de Premier ministre.
Cette alliance vitale avec les ultra-orthodoxes pousse la droite israélienne à ménager les volontés de ces derniers, et à abonder régulièrement dans leur sens. Cependant, avec près de 400 000 enfants scolarisés dans des écoles talmudiques de l’État hébreu, la plainte de l’association « Sortir pour changer » s’est transformée en enjeu de société.
Il faut dire également que la question ne concerne pas uniquement la société israélienne. De l’autre côté de l’Atlantique, à plus de 8000 kilomètres de la terre sainte, la question du droit à une éducation séculière se pose aussi.
Ainsi au Québec, un couple d’anciens Juifs ultra-orthodoxes ayant eux aussi quitté leur communauté ont décidé de porter plainte contre un État canadien qui ne leur aurait pas assuré une éducation de base. Aujourd’hui presque quarantenaires, Yochonon Lowen et Shifra Wassertein ont grandi coupés du monde qui les entourait, étant scolarisés dans une école talmudique. À Boisbriand, en banlieue de Montréal, ils ont été élèves d’établissements considérés illégaux par les autorités québécoises.

Les autorités connaissent l’existence de ces écoles depuis plusieurs années. Néanmoins, elles n’ont jamais pris de mesures pour réguler la situation. « D’où l’intérêt de la plainte », explique leur avocate maître Poissant-Lespérance. « Si on gagne, le gouvernement ne pourra pas rester dans une situation d’illégalité sous peine de violer ses obligations en matière d’instructions publiques. »
Comme en Israël — et à quelques semaines près —, un juge québécois vient de valider, le 15 mai, la plainte du couple d’anciens ultra-orthodoxes. Sur le banc des accusés : le ministère de l’Éducation du Québec, les écoles concernées, et le principal rabbin de la communauté Tash (NDLR, une communauté très rigoriste dont sont issus Yochonon et Shifra).
Le couple raconte avoir pris la décision de quitter leur communauté pour que leurs quatre enfants aient accès à une éducation complète, et laïque. Le couple évoque Tash comme « une prison intellectuelle ».
L’étendue de leurs lacunes est difficilement quantifiable. Leur avocate raconte souvent cette anecdote révélatrice : « Quand ils ont quitté leur communauté, ils ont découvert la ville de Montréal. Yochonon a alors demandé : « C’est quoi ça ? » C’était le fleuve Saint-Laurent. C’est comme si en France, quelqu’un qui a vécu toute sa vie en région parisienne ne savait pas que la Seine coule dans la capitale. Ni même d’ailleurs ce qu’est un fleuve ! »
Interrogé sur un plateau de télévision québécois, Yochonon Lowen a expliqué qu’il a décidé de poursuivre les institutions pour négligences envers les enfants, victimes tout comme lui. « Notre jeunesse, notre vie, notre enfance et toute notre éducation nous ont été volées ».










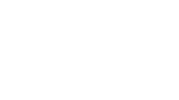
0 commentaires