A l’université d’Ottawa, un groupe d’étudiants a demandé la suspension d’un cours de yoga. Cette pratique venue d’Inde serait une appropriation culturelle des Occidentaux.

Au Canada, prendre la posture du lotus ou du triangle peut être perçu comme une offense à la culture indienne : sur le campus de l’université d’Ottawa, des cours de yoga ont récemment été supprimés. Pour la Fédération étudiante qui a exigé cette suspension, le yoga serait une « inacceptable “appropriation culturelle” d’une pratique non-occidentale », relève The Independent. Dans un mail envoyé à la professeure responsable du cours, Jennifer Scharf, l’un des représentants de cette fédération justifie leur choix :
« Bien que le yoga soit une très bonne idée, et qu’il soit à la fois accessible et bénéfique pour les étudiants […], sa pratique implique des questions culturelles. »
Venu d’Inde, ancienne colonie britannique, le yoga ferait donc partie de ces cultures importées et malmenées par l’Occident. Un symbole de l’« appropriation culturelle », en somme, notion que la CBC définit comme la manière dont « une culture, vue comme oppressive, emprunte ou vole certains éléments à une autre culture, victime de cette oppression ». Dans le même mail, la Fédération poursuit :
« Beaucoup de ces cultures ont subi l’oppression, le génocide culturel et les diasporas, et ce à cause de la colonisation et de la suprématie occidentale. Nous devons avoir cela à l’esprit quand nous pratiquons le yoga ».
Un mouvement, baptisé « Take Back yoga », tente ainsi de redonner le sens initial au yoga, loin de la marchandisation qui a pu être faite de cette activité. La Fondation américaine hindou, citée par le Washington Post, est à l’origine de cette campagne :
« Alors que l’industrie multi-milliardaire du yoga continue de s’étendre, en implantant des studios qui fleurissent comme des cafés Starbucks, ou en vendant des pantalons de yoga à 120$, la commercialisation massive de cette pratique antique, issue de la pensée hindoue, nous inquiète ».
S’agit-il d’un excès de politiquement correct, comme le suggère The Independent ? Sur le site de la CBC, Dilip Waghray, Hindou adepte du yoga, témoigne ; et « bien qu’il n’aime pas trop la manière dont cette pratique s’est commercialisée, il choisit de se concentrer sur les bienfaits que cela peut apporter ». Sur certains blogs, ou encore sur le site Slate.com, on vante ainsi les bienfaits de la mixité culturelle. Sans pour autant balayer du revers de la main cette question de l’appropriation culturelle. Mais, comme le relève le site américain, encore faut-il savoir d’où vient au départ cette culture, et comment elle a été « appropriée » :
« Dans le cas du yoga, ce serait complètement ignorer le rôle des Indiens eux-mêmes, qui se sont efforcés conjointement à exporter le yoga vers l’Occident depuis le XIXe siècle. […] Ils le voyaient comme un moyen de compromettre le colonialisme britannique ».
Quand une blogueuse de la version canadienne de Métro se demande ironiquement « est-ce que cela signifie que nous devrons bientôt renoncer à manger des spaghetti, à porter des kimonos ou à écouter du rap ? », Slate conclut avec des mots de Kwame Anthony Appiah , auteur de Pour un nouveau cosmopolitisme :
« Les cultures sont faites de continuités et de changements, et l’identité d’une société peut survivre à ces changements. Les sociétés qui ne changent pas ne sont pas authentiques : elles sont mortes ».



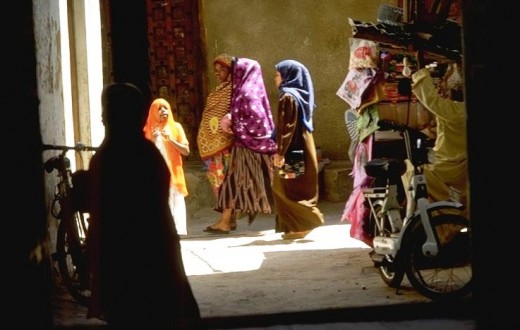
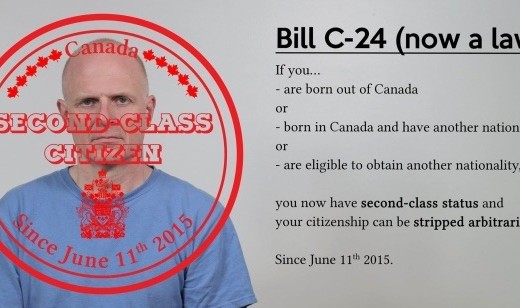



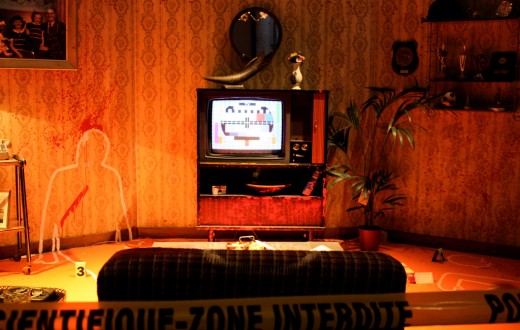
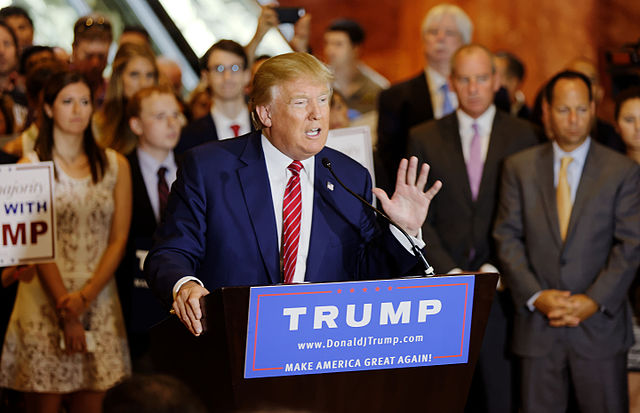
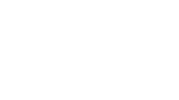
0 commentaires