En août dernier, la Cour suprême indienne jugeait que les Indiens devaient bénéficier d’un droit fondamental à la vie privée. Au-delà de son caractère historique, cette jurisprudence pourrait servir de fondement à la dépénalisation de l’homosexualité dans le pays, les juges ayant insisté sur le fait que « la discrimination contre un individu sur la base de son orientation sexuelle [était] une atteinte profonde à la dignité et au respect de l’individu ».

La décision de la Cour suprême indienne faisait la Une des journaux en août dernier : les Indiens bénéficient d’un droit fondamental à la vie privée. Ce faisant, la plus haute juridiction du pays risquait de remettre en cause le stockage systématique de données sur l’ensemble de la population — en 2009, l’Inde a en effet introduit le projet Aadhaar (NDLR, « fondation » en hindi) ; il concerne près d’un milliard de citoyens qui doivent s’enregistrer en fournissant leur adresse, leur date de naissance, leur numéro de téléphone, mais aussi leurs empreintes digitales et d’iris pour obtenir un numéro d’identification unique leur donnant accès à une vaste palette de services publics ; il s’agit tout simplement du plus grand relevé d’identité numérique au mondee.
Nul doute que la nouvelle jurisprudence aura d’importantes conséquences dans de nombreux domaines. Elle pourrait notamment servir de fondement à la dépénalisation de l’homosexualité, sujet qui demeure encore tabou aussi bien au sein de la société civile qu’au niveau du gouvernement, comme le souligne Public Radio International (PRI).
Ainsi, Dhananjaya Chandrachud, l’un des juges de la Cour suprême à l’origine de cette décision, a déclaré que “l’orientation sexuelle est un attribut essentiel de la vie privée” et que “la discrimination contre un individu sur la base de son orientation sexuelle est une atteinte profonde à la dignité et au respect de l’individu”. Il a ensuite ajouté que “le droit à la vie privée et la protection de l’orientation sexuelle se trouvent au cœur des droits fondamentaux garantis par la Constitution”. Des déclarations qui ont sans nul doute redonné espoir à la communauté LGBT indienne.
En effet, de nos jours le Code pénal indien continue de pénaliser les « rapports charnels contre nature ». Cette loi — qui peut en théorie être appliquée pour criminaliser les relations sexuelles entre n’importe quels adultes consentants ayant des relations sexuelles dans un autre but que de procréer — a jusqu’alors majoritairement été utilisée contre les homosexuels. Elle peut les conduire à passer plusieurs années de leur vie en prison.
PRI cite en exemple le cas de Ramchandra Siras, un linguiste, professeur d’université et auteur de plusieurs nouvelles qui lui avaient notamment valu un prix littéraire en 2002. L’homme, qui enseignait la littérature marathie à l’université musulmane d’Aligarh depuis 1998, avait été marié pendant plus de vingt ans avant de divorcer. Sa vie a basculé en 2010, lorsqu’à seulement quelques mois de la retraite il a été filmé en train d’avoir une relation sexuelle avec un homme par des reporters entrés de force chez lui. Immédiatement suspendu par son université, l’homme a mis fin à ses jours deux mois plus tard, à l’âge de 60 ans.
À en croire Anjali Gopalan, le directeur de l’ONG Naz Foundation, à l’origine d’une pétition contre la loi homophobe, la nouvelle jurisprudence pourrait permettre d’empêcher qu’une situation de ce genre ne se reproduise : “La chose à laquelle je n’arrête pas de penser, c’est que si nous avions eu ce jugement en place, cela ne se serait probablement pas produit”. L’homme espère désormais que le Code pénal indien sera prochainement amendé par les juges.
Cependant, le problème demeure loin d’être résolu dans la mesure où le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi continue d’apporter son soutien à la loi homophobe. Son parti, le Bharatiya Janata Party, a en effet refusé d’abroger la loi lors d’un vote au Parlement en 2014, et ce malgré l’existence d’une majorité se disant en faveur d’un tel changement.
Par le passé, plusieurs leaders du parti ont fait savoir qu’ils étaient très clairement contre une dépénalisation. En 2013, l’ex-président du Bharatiya Janata Party, Rajnath Singh, avait même été jusqu’à déclarer que “l’homosexualité est un acte contre nature et ne peut pas être encouragée”. En 2015, une autre tête d’affiche, Subramanian Swamy, expliquait considérer que “les homos sont génétiquement handicapés”.
Reste maintenant à savoir comment l’exécutif compte réagir face à la nouvelle jurisprudence. Les premiers signes ne sont pas très encourageants. Ainsi, lorsqu’on lui a demandé son opinion, le ministre de la Justice, Ravi Shankar Prasad, a tout simplement botté en touche en déclarant qu’il pensait qu’il s’agissait “d’un jour important pour les pauvres et les défavorisés”, s’attirant par la même occasion les foudres des associations de défenses des droits de la communauté LGBT qui l’accusent de vouloir réduire la question du droit des homosexuels à “un problème de riche”.
« Prasad dit que les droits des gens pauvres sont importants, je peux lui faire rencontrer des milliers de gens pauvres et membres de la communauté LGBT », s’énerve par exemple un activiste indien du nom d’Harish Iyer. “Ils ne viennent pas tous d’une strate socio-économique aisée”, ajoute-t-il.
L’homme se dit dubitatif à l’idée que le jugement suffise à lui seul à faire reculer l’homophobie dans son pays. Il se dit néanmoins confiant à l’idée que l’Inde vient de faire un pas dans la bonne direction : “Quand l’amour sort du placard, la haine sort également du placard. Mais maintenant, la loi ne sera plus une excuse pour nous empêcher d’apporter de l’aide aux gens”.










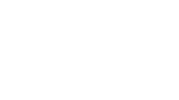
0 commentaires