
Comme beaucoup d’étudiants, Baudouin a décidé de boucler sa licence par une année à l’étranger. Il a choisi le Vietnam. Arrivé à Saigon, il a rencontré Quentin un jeune directeur artistique qui a choisi de partir chercher du travail en Asie. Un jour, alors que les images des plages dévastées tournent en boucle sur les chaînes d’infos vietnamiennes, les deux Belges décident, sur un coup de tête, de partir à Tacloban pour venir en aide aux victimes de l’une des villes côtières les plus touchées par le typhon qui a ravagé les Philippines du 3 au 11 novembre 2013.
« Fin de journée, je regarde les infos. Encore une fois, ils parlent de chômage. Encore une fois, il y a eu une catastrophe, celle-ci causée par le typhon Haiyan », raconte Quentin sur Stand Up Tacloban, un blog qu’il a monté avec son ami Baudouin pour raconter leur aventure aux Philippines. « Je vois les images d’un gamin devant un message, “HELP US”, tagué dans les décombres d’une ville dévastée. » Le JT se termine et Quentin repense aux images qu’il vient de voir, à toutes ces catastrophes relayées par les médias, que les gens observent, impuissants dans leur canapé. Il se demande combien de personnes se lèvent d’un bond, en se disant qu’ils vont réagir à cet appel au secours lancé par des gens qui ont tout perdu.

Le lendemain, Quentin rejoint Baudoin. Alors qu’ils traversent le centre de Saigon en moto, il lui raconte ce qu’il a vu aux infos la veille : les ravages d’un super typhon, équivalent à un ouragan de catégorie 5, avec des bourrasques de vent jusqu’à 315 km/h. Baudouin est parti aux Philippines trois mois plus tôt en vacances. Les souvenirs des plages de sable fin et des eaux turquoise qu’il a en tête sont douloureux à confronter à ce que Quentin évoque et que lui aussi voit à la télévision depuis plusieurs jours. Baudouin rentre chez lui et, en plein milieu de la nuit, sort son ordinateur pour commander un billet d’avion pour la fin de semaine, direction Tacloban, la capitale des Visayas orientales, sur l’île de Leyte, aux Philippines. Sans assurance annulation. Au matin, Baudouin annonce son départ à Quentin par téléphone. Sur le point de lancer un site d’achat de tableaux en ligne et avec le travail l’attend, il est content que son ami puisse y aller à sa place. Il raccroche, réfléchit deux minutes, puis le rappelle pour lui annoncer que les tableaux attendront et qu’il l’accompagne. Quentin réserve un vol qui part deux jours plus tard, faute de place dans celui de Baudouin. « On n’a pas trouvé de bonne raison de ne pas y aller. Les Philippines sont à trois heures de vol de Saigon donc on s’est dit que c’était l’occasion idéale. »
Avec seulement quatre kilos d’affaires personnelles sur les 40 autorisées par la compagnie aérienne, les deux jeunes Belges sillonnent Saigon pour trouver des provisions à apporter aux Philippins. « Une fois mon sac bourré de médicaments, de gants de travail et de nourriture séchée, j’ai pris ma moto direction l’aéroport de Saigon », raconte Baudouin. Il arrive aux Philippines le 18 novembre, une semaine après que le typhon Haiyan a frappé l’archipel. Le bilan provisoire est déjà fixé à 4000 morts par le gouvernement philippin. « Au début, c’est très difficile de s’intégrer, du coup j’ai rejoint un pasteur que j’avais rencontré dans l’avion et j’ai commencé à porter des sacs de provisions qui seraient ensuite distribués dans les quartiers de Tacloban. Il y avait des tonnes de choses à faire, mais c’était compliqué d’arriver, comme ça, et de proposer son aide, surtout quand on n’est mandaté par aucune association. » À la nuit tombée, n’ayant nulle part où dormir, il pose un carton sur le sol devant la mairie avant de se faire inviter dans le bureau du maire.

« Je me suis rendu compte que pas mal d’ONG venaient pour se prendre en photo et se faire de la pub plutôt que pour aider. Souvent, durant les jours qui ont suivi, on a eu des problèmes avec certaines d’entre elles qui voulaient gérer le plus de trucs possible. Ça leur permettait ensuite d’obtenir plus de subventions ou de faire des campagnes pour réclamer des dons. Tout était très politique, mal organisé et on a perdu un temps fou. » Pas spécialement content de cette expérience, Baudouin décide de chercher d’autres personnes avec lesquelles travailler le lendemain. En attendant Quentin, il travaille avec des « cash for workers », des Philippins rémunérés environ 250 pesos (5 €) par jour par le gouvernement pour nettoyer leur propre quartier. Le « cash for work », à l’initiative de l’ONU, a déjà fait ses preuves à Sumatra (2004) et en Haïti (2010). Il refait surface à chaque catastrophe naturelle pour relancer l’économie quand toutes les banques ont fermé et que la population a perdu son argent.
Pendant ce temps, à Saigon, Quentin essaye de se renseigner et cherche une association avec laquelle ils pourront travailler. « Les grosses ONG nous disaient de passer par Internet, de remplir un formulaire et d’attendre d’être recontactés. D’autres m’ont simplement répondu qu’ils ne prenaient pas de volontaires alors que j’avais déjà mes billets, que Baudouin était déjà sur place et qu’on demandait juste à travailler. Finalement, une femme d’ASF (Aviation sans frontière, ndlr) m’a conseillé d’aller sur place. Pour elle, c’était là-bas qu’on avait besoin de nous. » Durant ces deux jours, Quentin a surtout le temps d’appréhender. L’adrénaline de la décision prise sur un coup de tête s’est dissipée et contrairement à Baudouin, il a le temps de cogiter. « Ma famille s’inquiétait énormément. Les médias disaient que c’était dangereux, qu’il y avait des pillages à main armée. Et puis, même en temps normal, les Philippines ne sont pas réputées pour être l’endroit le plus sûr du monde… »

Comme prévu, Quentin arrive le 20 novembre à Tacloban. Le temps de poser ses affaires dans le bureau du maire et il rejoint Baudouin pour commencer à travailler à Anibong, un des quartiers les plus pauvres de la ville. Sept bateaux s’y sont échoués, détruisant la majeure partie des habitations. « Le travail n’était pas compliqué, plutôt fatigant. Il fallait trier le bois, le métal et le plastique parmi les débris pour tout recycler ensuite. Mais c’était génial. On a distribué les gants qu’on avait emmenés et on s’est mis à bosser. C’est une des meilleures journées qu’on ait passées. Les Philippins étaient hyper sympas, très loin de ce qu’on nous avait dit ou de ce qu’on peut entendre sur ce quartier réputé “le plus dangereux de la ville“. »
Dix jours après le passage du typhon et alors que le bilan a atteint 5200 morts et 1611 disparus, Baudouin – sur place depuis trois jours – et Quentin – depuis 24 heures – sont les seuls occidentaux à Tacloban à être venus spontanément pour aider. « On était persuadés qu’une fois là-bas, on serait pris en charge par une association qui s’occupait de gens comme nous. Mais il n’y avait rien de prévu. Nous étions les deux seuls blancs hormis les gens qui travaillaient pour des ONG, que nous voyions passer dans leurs gros 4×4. » Baudouin et Quentin finissent par rejoindre Mike, un entrepreneur dans le bâtiment d’une cinquantaine d’années venu de Manille qui, comme eux, ne dépend d’aucune association et en qui la mairie de Tacloban a confiance, ce qui lui permet de se voir confier des tâches

Après deux jours passés à travailler sur divers chantiers, Mike parle de Baudouin et Quentin à l’UNDP (Programme des Nations unies pour le développement), une branche de l’ONU. Ils signent alors un contrat avec l’ONG qui recherche activement des “contractors”, à savoir des gens sur place qui vont travailler avec l’UNDP en restant malgré tout relativement indépendants. Les deux jeunes Belges sont alors chargés de piloter une équipe de cash for workers philippins. « En une journée et demie, on a nettoyé une rue entière alors qu’on pensait mettre des semaines », raconte Baudoin. Le soir venu, ils rejoignent une maison louée par l’UNDP, la seule du quartier équipée d’un générateur. « Les gens venaient profiter de la lumière et recharger leur téléphone. On a vécu de super moments pendant ces soirées. »
Les jours suivants, le travail commence à s’automatiser pour « Tom et Tintin », les surnoms que les enfants de Tacloban ont donnés aux deux Belges. Au fur et à mesure que les bennes se remplissent, les rues retrouvent leur apparence d’avant la catastrophe. Des cargaisons de riz arrivent de la capitale, estampillées “Made in Philippines” même si depuis quelques jours la rumeur court que le président Aquino a ordonné que les dons étrangers soient transférés dans des sacs philippins. Les déblaiements sont de plus en plus profonds et la location par l’UNDP de pelleteuses – qui ont résisté à l’eau de mer – rend le travail beaucoup plus rapide.

Même s’ils en ont déjà vu des centaines dans des sacs noirs au bord des routes, Baudouin et Quentin sont confrontés à leur premier cadavre au bout d’une semaine. Mais le détachement des Philippins par rapport à ce genre de découvertes leur permet de supporter cette expérience redoutée mieux qu’ils ne le craignaient. Le corps semble être celui d’un étranger, mais Quentin et le travailleur qui l’ont découvert ne trouvent rien dans ses poches pour l’identifier. Ils le mettent alors dans un body bag et le déposent sur le bord de la route, avec les autres. Sur le coup, Quentin ne se sent pas affecté. « Il ne faut pas considérer les morts autrement que comme des débris si on veut tenir », explique-t-il. D’autant que la situation est inhabituelle. « C’est rare pour les Philippins de découvrir un cadavre d’Occidental. Ils m’ont demandé en rigolant si c’était mon frère vu que nous étions tous les deux blancs. Je sais que ça peut difficilement prêter à sourire, mais c’était un moyen pour eux de communiquer leur soulagement de ne pas avoir découvert une énième victime philippine. Un ami ou peut-être un proche. »
Les équipes sont de plus en plus fournies et une routine s’est presque installée parmi les travailleurs qui nettoient de plus en plus efficacement. Et la réalité vient de nouveau ébranler le quotidien des deux Occidentaux. Le 8e jour, pendant que les équipes continuent de déblayer le champ où a été découvert l’étranger, la veille, Baudouin et Quentin travaillent au nettoyage d’une école dans le quartier de San Jose, sur la presqu’île. Cela fait déjà deux jours qu’ils se démènent pour faire disparaître toute trace de la boue épaisse et malodorante qui a inondé l’école. « Arrivé au bureau du principal, un de nos gars a eu un doute sur ce qu’il avait trouvé : est-ce que c’était une poupée ou le corps d’un bébé ? Malheureusement ce n’était pas un jouet. On a déposé le garçonnet d’un an environ en dehors de l’école. » La macabre découverte marquera la fin de la journée de travail pour les femmes qui participaient au chantier.

Le lendemain après-midi, dernier jour de leur périple, le nettoyage de l’école est presque terminé et un petit groupe de personnes pénètre dans le bâtiment. Le proviseur et des instituteurs, émerveillés, viennent constater le résultat des trois jours de travail et valident la réouverture des classes, prévue pour le lundi suivant. Dans le fond, un homme reste seul et silencieux. Quentin apprend par le chef d’établissement qu’il a perdu sa femme, professeure dans l’école, ainsi que son enfant d’un an et demi probablement mort dans l’établissement. « À ce moment précis, on a réalisé que ce qu’on avait considéré pendant un instant comme une poupée était l’enfant décédé d’un homme qu’on avait en face de nous. Ce père au regard vide restera pour nous l’une des images les plus marquantes du voyage », racontent-ils.
Les dix jours que s’étaient donnés Baudouin et Quentin se sont écoulés et il est temps pour eux de dire au revoir à toutes les équipes. Un détour par la mairie pour saluer l’adjoint du maire et récupérer un polo “I Love Tacloban” – qu’ils se dépêcheront d’enfiler à la place de leur t-shirt sale – et les voilà dans le pick-up direction l’aéroport. Pour les deux Belges, le retour à la vie réelle est difficile. Baudouin est retourné à la fac et Quentin a repris son business de vente de tableaux en ligne là où il l’avait laissé une semaine plus tôt…
Avant qu’ils ne laissent à nouveau tout tomber mi-janvier pour retourner à Tacloban. Ils y sont désormais depuis un mois et demi et leurs rôles au sein de l’UNDP ainsi que la vie à Tacloban n’ont plus rien à voir avec leur première expérience.
La suite de ce récit ici.
Le journal de Quentin Musset et Baudouin Nachtergaele est disponible sur StandUpTacloban. Toutes les photos sont la propriété de Quentin Musset et Baudouin Nachtergaele.




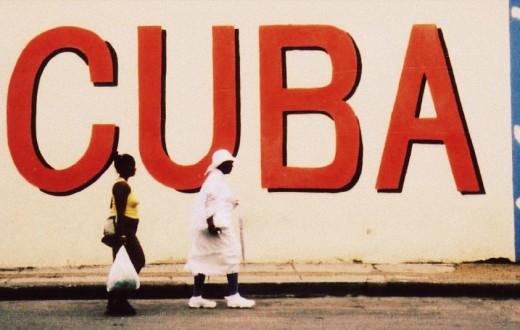





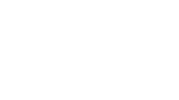
Pingback: Quentin et Baudouin : du canapé au désastre philippin (2/2) | 8e étage